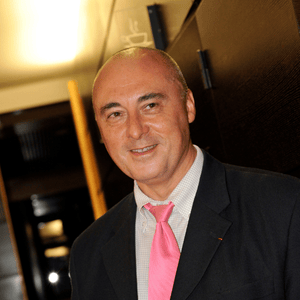«Lorsqu’une profession accède au statut ordinal ses honoraires moyens augmentent»
Expert reconnu du monde de l’immobilier, Henry Buzy-Cazaux est président de l’Institut du Management des Services Immobiliers (IMSI) et membre du Conseil national de l’habitat (CNH).
Fin juin, il a présenté en séance plénière du CNH, le rapport L’avenir du métier de syndic de copropriété et de son rôle dans la transition environnementale des immeubles collectifs.
Qu’apporterait la création d’un ordre professionnel des syndics ?
Le rapport que j’ai rendu au Conseil national de l’habitat a examiné plusieurs voies pour renforcer le cadre actuel des syndics professionnels. L’hypothèse d’un ordre est l’une de celles qui ont été étudiées : dans la communauté, elle est souvent évoquée et depuis longtemps. Notre groupe de travail ne pouvait pas ne pas y réfléchir. Pour moi, je l’ai évoquée dès 2008… et elle a inspiré le livre blanc des fédérations qui a lui-même soufflé au législateur la création du CNTGI. Et pour aller au bout de l’historique, la possibilité d’un ordre remonte bien plus loin : deux congrès de la CNAB, devenue l’UNIS, avaient suggéré cette évolution du droit dans les années 80 et 90 ! Enfin, peu savent que lorsque le député Hoguet a déposé en 1969 une proposition de loi pour encadrer les activités de gestion et de transaction, une autre initiative parlementaire proposait, elle, un ordre pour les administrateurs de biens et les agents immobiliers.
Cette chronologie démontre que la profession a au fond d’elle une envie d’ordre, pour trois raisons : elle considère manier des enjeux supérieurs, comme les grandes professions du droit, du chiffre ou de la santé ; elle entend que l’exigence et la rigueur prévalent et elle veut de la respectabilité, trois caractéristiques des ordres. Aujourd’hui, plus encore que par le passé, les enjeux dont les syndics ont la charge sont plus nombreux et plus lourds, la lutte contre l’indécence, la transition environnementale, mais aussi la cohésion sociale avec l’éradication des marchands de sommeil, des violences conjugales et familiales, du narcotrafic, toutes missions auxquelles il leur est demandé d’apporter leur concours. À cet égard, ils considèrent d’ailleurs sortir du lot des professions «loi Hoguet».
Alors, qu’est-ce qui empêche un ordre de se créer ? Je pense que la profession a trop appris à vivre sans ce cadre et a développé trop de solutions différentes pour que cette voie soit identifiée comme une priorité de ses demandes aux pouvoirs publics. Les syndicats veillent à l’orthodoxie, certes avec des limites de pouvoir : ils ne peuvent sanctionner comme le fait un ordre et une exclusion ne vaut pas interdiction de travailler. En outre, beaucoup de contre-vérités ont circulé sur l’ordre : il serait contraire à l’Europe, hostile à la surrégulation, alors qu’un ordre dérégule puisqu’il confie à une profession son destin sous contrôle de l’État. On a aussi entendu qu’un ordre rajoutait des contraintes… mais les syndics les ont déjà toutes, issues de maintes lois !
Si un ordre voyait le jour, le CNTGI n’aurait plus de raison d’être, mais justement, depuis 2014, il contribue activement à l’ajustement de la réglementation. Sa dimension disciplinaire va voir le jour avec la nomination prochaine de la commission, mais elle n’aura qu’un pouvoir d’alerte, bien loin de l’intention du législateur de 2014. Une demande du rapport consiste à en revenir aux pouvoirs de sanction de la loi ALUR. Faut-il déduire de cette analyse que l’ordre restera un phantasme ? Non, je ne le crois pas. Il faut peut-être qu’une mission parlementaire, comme pour les diagnostiqueurs immobiliers à l’initiative de la ministre du logement, soit confiée. Je vois également un autre catalyseur : les honoraires. La profession peine à faire reconnaître sa valeur ajoutée. Or, la preuve est faite que lorsqu’une profession accède au statut ordinal ses honoraires moyens augmentent à l’aune du regard réévalué porté sur elle. Ce constat ne peut que faire réfléchir la communauté des syndics…
L’intelligence artificielle : opportunité ou frein pour la profession ?
L’intelligence artificielle est une chance pour tous les métiers du monde, comme le digital l’a été, et tant d’autres progrès technologiques. Deux bénéfices évidents : la facilitation de nombreuses tâches, de recherche, d’argumentation, de rédaction, de communication, dont les syndics ont l’usage permanent ; ensuite la valeur ajoutée majorée, par le gain de temps, certes, mais aussi par la plus grande complétude des analyses et des réponses apportées, tant dans le champ juridique que technique. En revanche, il faut que la profession mesure ce que cette chance emporte d’exigence : l’IA déplace la valeur ajoutée de l’intelligence humaine vers le haut. Si la machine en fait beaucoup plus, mon apport de gestionnaire va devoir se placer au-dessus, dans le discernement, dans le conseil, dans la stratégie. Par ailleurs, l’IA va niveler : tous mes confrères ont le même accès que moi à cet outil puissant. Je vais donc devoir me différencier par mon apport au-delà du recours à l’IA. En somme, les syndics ne vont pas travailler moins, mais vont démontrer leur propre intelligence dans l’approche des dossiers et des situations. Pour des étudiants d’écoles immobilières, qui se forment aux niveaux bac+3 voire de plus en plus souvent bac+5 pour devenir syndics, c’est enthousiasmant.
D’après le rapport, la communauté d’intérêts qui avaient inspiré la loi de 1965 n’existe plus. Comment l’expliquez-vous ?
C’est plutôt que les communautés d’intérêts au sein des immeubles collectifs, entre 1965 et aujourd’hui, se sont incroyablement compliquées. Lorsque la loi a vu le jour, vous aviez dans une copropriété une homogénéité sociale, économique, culturelle. Elle existe de moins en moins. C’est une richesse et un défi pour les syndics. Il leur appartient de piloter des communautés forcées - personne ne choisit son voisin de palier ! - très éclatées.
Comment faire voter sur un projet commun un couple de jeunes accédants endetté avec des actifs aux revenus établis, et des seniors qui voient moins l’intérêt de moderniser leur immeuble, ou des copropriétaires en difficultés financières après un licenciement ou un divorce ? Mais le bien vivre ensemble passe désormais aussi par le respect ou la tolérance religieuse et de mœurs. On ne peut se cacher ces vérités. Pour ces raisons, la loi n’est pas périmée, elle est juste beaucoup plus délicate à faire fonctionner. Les syndics doivent à la fois être fiers de relever ces défis, formés à y réussir et reconnus pour accomplir cette mission, socialement et en termes de rémunération.