Nombreux sont les syndics qui ont développé des filiales : assurance, diagnostics techniques, bureaux d’études... Un état de fait que l’on constate surtout chez les grands groupes nationaux, ces derniers étant souvent entourés par une véritable nébuleuse de sociétés de prestations de services. Si la pratique n’a rien d’illégale, elle nécessite cependant une information préalable des copropriétaires et peut, dans certains cas, se heurter aux obligations déontologiques auxquelles tout syndic est tenu.
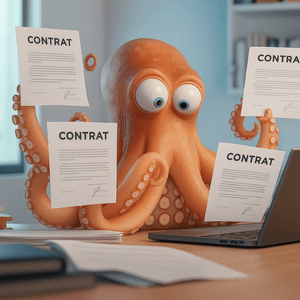 L’information préalable des copropriétaires
L’information préalable des copropriétaires
Dans un souci de transparence, le législateur a imposé au syndic une obligation d’information envers les copropriétaires lorsqu’il souhaite contracter, pour le compte du syndicat, avec une entreprise à laquelle il est lié.
Ainsi, le syndic soumet à l’autorisation de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24 «toute convention passée entre le syndicat et une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l’autorisation de la convention» (art. 18-1 A II, L. 1965). Un texte qui a été modifié par l’ordonnance de réforme du 30 octobre 2019, réadaptant l’ancien septième alinéa de l’article 18, qui imposait déjà la saisine préalable de l’assemblée générale avant la souscription d’une convention pouvant potentiellement faire l’objet d’un conflit d’intérêt.
Par ailleurs, aux termes de l’article 39 du décret du 17 mars 1967, doit également faire l’objet d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale toute convention conclue entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus. Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les proches du syndic ainsi définis sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont ils sont salariés ou préposés.
Toujours dans un souci de prévention des risques de conflit d’intérêts, le syndic, lorsqu’il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.
Dans tous les cas, qu’il s’agisse de liens capitalistiques, juridiques ou familiaux, le syndic est tenu d’en préciser la nature afin d’expliquer en quoi ils rendent nécessaire l’autorisation de la convention.
On notera que le vote concerne l’autorisation accordée au syndic de contracter avec une entreprise à laquelle il est lié, et non l’approbation elle-même de la convention. Autrement dit, il convient d‘organiser deux votes, le premier sur l’autorisation de l’assemblée, montrant ainsi qu’elle a été parfaitement informée des liens existants entre le syndic et l’entreprise en question, le second sur la convention elle-même, notamment le prix du marché. Procéder à un vote unique pourrait s’avérer contestable, quand bien même le syndic aurait-il mentionné dans le corps de la résolution la nature des liens existants.
Mise en concurrence et droit du travail
Certains syndics prévoient dans le contrat de travail de leurs salariés une clause leur imposant de proposer, de manière obligatoire, systématique et exclusive, les sociétés avec lesquelles l’employeur aurait mis en place un partenariat (courtage de prêts immobiliers, diagnostics…). A défaut, le salarié s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. Or, une telle stipulation, au-delà des éventuelles questions liées à sa validité au regard du droit du travail, n’est pas sans susciter quelques interrogations inhérentes au domaine de la copropriété. En effet, cette clause va à l’encontre des articles 8 et 9 du Code de déontologie des professionnels de l’immobilier imposant au gestionnaire, d’une part, de veiller à la promotion des intérêts légitimes de leurs mandants et, d’autre part, de limiter les situations pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts (voir D. n° 2015-1090 du 28 août 2015).
Surtout, il appartient à l’assemblée générale d’arrêter, à la majorité de l’article 25, un montant au-delà duquel une mise en concurrence est obligatoire (art. 21, L. 1965). De plus, le règlement de copropriété peut également prévoir certaines modalités et exiger la présentation de plusieurs devis. Le syndic ayant l’obligation de faire exécuter les résolutions d’assemblée générale et d’appliquer les dispositions du règlement de copropriété, il ne saurait imposer uniquement des prestataires avec lesquels il aurait noué un partenariat.
Conséquences du défaut d’habilitation du syndic
Faute d’information préalable des copropriétaires sur la nature des liens capitalistiques, juridiques ou familiaux entre le syndic et l’entreprise en question, et en l’absence d’autorisation expresse de l’assemblée générale, la convention conclue est inopposable au syndicat des copropriétaires. Le législateur n’a pas opté pour le régime de la nullité, estimant sans doute que le cocontractant n’avait pas à être pénalisé pour une faute dont il n’est pas à l’origine, même si, au regard des liens existants entre lui et le syndic, il est fort probable qu’il soit informé de la situation. Cela permet surtout d’éviter des conséquences fâcheuses, notamment en cas de réalisation de travaux, la nullité pouvant alors entraîner la remise des lieux en leur état initial, ce qui peut ne pas être chose aisée. L’inopposabilité de la convention a donc l’avantage de ne pas pénaliser le syndicat des copropriétaires, le contrat demeurant valable, mais l’on ne saurait lui imposer les obligations qui en découlent, notamment financières. Il appartiendra ainsi au syndic d’en supporter seul le coût.




